Visitez le site anglais du
WSWS
SUR LE SITE :
|
Contribuez au WSWS |
| Nouvelles et Analyses |
| Luttes Ouvrières |
| Histoire et Culture |
| Correspondance |
| L'héritage que nous défendons |
| A propos du CIQI |
| A propos du WSWS |
AUTRES
LANGUES
Allemand
Français
Anglais
Espagnol
Italien
Indonésien
Russe
Turque
Tamoul
Singalais
Serbo-Croate
Réunion du comité de rédaction international du WSWS
Rapport sur l’économie mondiale en 2006
Par Nick Beams
Nous publions ci-dessous la deuxième partie d'un rapport présenté par Nick Beams lors d'une réunion élargie du comité de rédaction international du WSWS. Beams est membre de ce comité et secrétaire national du Parti de l’égalité socialiste (Australie), qui était l’hôte de la réunion, tenue à Sydney du 22 au 27 janvier 2006. La première partie a été publiée le 22 juin. La troisième et dernière partie sera publiée le 24 juin.
Deuxième partie
23 juin 2006
Utilisez cette version pour imprimer
Les contradictions économiques de la Chine n’ont d’égales que celles des États-Unis. En fait, les deux sont déterminées par les mêmes processus économiques mondiaux. Les économies chinoise et américaine sont intimement liées en une symbiose financière, dans laquelle les États-Unis s’endettent de plus en plus afin de fournir les marchés d’exportation nécessaires à la croissance de l’économie chinoise et de l’économie mondiale au complet. Au même moment, les banques centrales de la Chine et de l’Asie orientale investissent leurs revenus d’exportation dans des marchés financiers américains pour continuer de faire fonctionner le processus.
L’expression la plus frappante du développement de la crise financière est l’augmentation de l’endettement extérieur des États-Unis. Le déficit actuel des États-Unis, qui se situe à environ 6,4 pour cent du PIB, pourrait atteindre 7,5 pour cent cette année, et on prévoit des pourcentages encore plus élevés pour le futur immédiat. Environ 75 à 80 pour cent des surplus extérieurs du reste du monde sont nécessaires pour financer le déficit américain. Cela signifie qu’une entrée de capital de plus de $2 milliards par jour est nécessaire pour garder les États-Unis solvables. L’économiste William R. Cline estime que le présent déficit pourrait s’accroître à $1,2 billion d’ici 2010 et que la dette des États-Unis, présentement autour de $2,2 billions, soit 23 pour cent du PIB, pourrait atteindre les 8$ billions, ce qui serait équivalent à 50 pour cent du PIB.
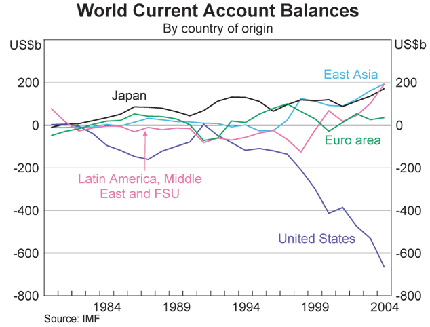
Selon Cline, plus longtemps est reporté un ajustement dans la situation d’endettement des États-Unis, plus importants seront les dégâts économiques. Un ajustement aujourd’hui exigerait des réductions de la demande intérieure pour l’investissement, la consommation et le déficit fiscal, équivalentes à 4 pour cent du PIB: des coupures considérables. Toutefois, si l’ajustement devait être reporté une décennie plus tard, une réduction équivalente à 9 pour cent du PIB serait nécessaire, ce qui déclencherait une importante récession mondiale.
La balance de paiements, toujours de plus en plus négative, n’est qu’un des importants déséquilibres de l’économie américaine. Cinq ans auparavant, lorsque la bulle des marchés boursiers américains a éclaté, l’économie américaine n’avait pas subi de grave récession et ce, en grande partie, à cause d’une série de baisses de taux d’intérêt initiée par la Réserve fédérale. Ces baisses, qui firent que certains taux à court terme devenaient négatifs, ont fourni le carburant financier nécessaire pour la création d’une bulle dans le marché de l’immobilier aux États-Unis. Selon une étude, l’ampleur de cette bulle serait de $5 trillions, soit environ 45 pour cent du PIB américain. Ces chiffres sont obtenus en faisant la différence entre la valeur actuelle des maisons sur le marché et la valeur qu’elles auraient obtenu si les prix des maisons avaient suivi la tendance historique à long terme depuis 1997, lorsque la bulle a commencé à se développer.
Cette croissance de la richesse financière, dans ce que l’on pourrait appeler l’économie virtuelle, contraste nettement avec les événements économiques de la réalité concrète. Par exemple, les derniers chiffres montrent que les salaires horaires et hebdomadaires réels étaient plus bas en novembre 2005 qu’un an auparavant. Depuis la reprise économique américaine en novembre 2001, les salaires horaires réels des travailleurs, excepté les cadres, ont diminué de 5 sous. Cependant, durant la même période, la productivité a augmenté de 13,5 pour cent.
En 2005, le nombre de salariés a augmenté de 2 millions, bien en deçà de la tendance historique. Pour des reprises de plus de 49 mois, la moyenne d’augmentation est de 3,1 pour cent. De mars 1991 à avril 1995, une période surnommée à l’époque «reprise sans emploi», le nombre de travailleurs a augmenté de 7,8 pour cent. Durant la période de novembre 2001 à décembre 2005, l’augmentation fut de 2,7 pour cent. L’année dernière, l’augmentation fut de 1,5 pour cent seulement. Durant la reprise précédente, le nombre de salariés avait augmenté de 3,5 pour cent pour une période semblable.
On a évalué que le nombre d’emplois aux États-Unis devrait être plus élevé de 8 millions à ce point-ci d’une reprise de récession. De plus, les emplois qui ont été créés sont au niveau le plus bas de l’échelle salariale. Des employeurs à bas salaires, comme Wal-Mart (le plus grand employeur américain), ont créé 44 pour cent des nouveaux emplois. Pendant ce temps, General Motors est au bord de la faillite.
Le revenu réel médian des ménages a baissé durant cinq années consécutives. L’endettement des ménages aux États-Unis, en tenant compte de l’inflation, a augmenté de 35,7 pour cent au cours des quatre dernières années. Le taux d’épargne personnelle est négatif pour la première fois au cours de la période d’après-guerre.
«L’énigme» de Greenspan
Dans son rapport semestriel présenté au Congrès des États-Unis le 16 février 2005, l’ancien président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, avait attiré l’attention sur certains déséquilibres de l’économie des États-Unis. Il fit remarquer que d’importantes augmentations des dépenses de consommation avaient été accompagnées par une chute des taux d’épargne personnelle à 1 pour cent en 2004, comparativement à un taux de presque 7 pour cent au cours des 3 décennies précédentes. Alors que «la hausse rapide du prix des maisons au cours des dernières années» avait fournit aux ménages «d’importants gains en capital», ces gains, «réalisés en grande partie par une augmentation de l’endettement hypothécaire sur la maison, n’augmentent pas l’épargne nationale disponible pour financer de nouveaux investissements de capitaux». Autrement dit, une augmentation du capital fictif avait pris place, mais pas une augmentation de la richesse réelle.
Du côté de l’entreprise, il fit remarquer que, malgré la progression de l’investissement en capital à «un rythme raisonnable», il tirait néanmoins de l’arrière sur l’augmentation des profits et de la marge d’autofinancement. «Cela est très inhabituel: il a fallu une profonde récession pour produire une telle situation en 1975» Les entreprises étaient peu disposées à réaliser de nouveaux investissements et «se concentraient sur le contrôle des coûts» Bien qu’il n’en ait pas fait la remarque, la situation actuelle était encore plus inhabituelle, étant donné qu’au moment de son rapport l’économie américaine en était à sa troisième année de reprise économique: une période où l’on s’attendrait à voir une augmentation de l’investissement d’entreprise.
La situation comportait d’autres aspects inhabituels. Malgré l’augmentation des taux d’intérêts à court terme par la Réserve fédérale, le taux obligataire à long terme a continué de chuter. Ce «comportement largement imprévu des marchés obligataires mondiaux», déclara Greenspan, «demeure une énigme».
Lors d’un discours en juin 2005, Greenspan fit remarquer que «le déclin prononcé des taux d’intérêt à long terme du Trésor américain durant la dernière année, malgré une augmentation de 200 points du taux des fonds fédéraux, est tout à fait sans précédent. Le Trésor affirme que le rendement sur dix ans est présentement à environ 4 pour cent, 80 points de moins qu’un an plus tôt». D’autres taux à long terme ont même chuté davantage.
La chute des taux à long terme sur les obligations à faible risque fut un des facteurs qui ont poussé les investisseurs à placer leur argent dans des obligations à haut risque, faisant baisser du même coup les taux d’intérêt. «La recherche du rendement», expliqua-t-il, «est particulièrement visible par les investissements massifs qui sont injectés dans les sociétés de financement par capitaux propres et dans les fonds spéculatifs. Ces entités ont été en mesure d’accumuler des ressources importantes de la part d’investisseurs qui recherchaient apparemment des taux de rendement ajustés à un risque plus haut que la moyenne. Ces investissements ne peuvent bien sûr être réalisés que par une minorité d’investisseurs. Et pour répondre à cette demande, les directeurs des fonds spéculatifs mettent au point des stratégies commerciales de plus en plus complexes pour exploiter ce que certains considèrent comme des opportunités d’arbitrage. On croit, dans beaucoup de cas, à tort, que ces opportunités peuvent offrir des taux de rendement exceptionnels»
En d’autres termes, la cause de ce phénomène sans précédent est que le capital financier, faisant sans arrêt le tour de la terre pour extraire du profit, doit maintenant entreprendre des investissements plus risqués pour réaliser le même taux de rendement que par le passé.
Lors d’un discours, le 10 mars de l’année dernière, le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, a porté son attention sur «l’énigme» de Greenspan. Après avoir exposé en détail la montée du déficit de la balance de paiements américain, de 1,5 pour cent du PIB en 1996 à plus de 6 pour cent aujourd’hui, Bernanke a insisté que ceci n’était pas un problème américain. «Je soutiens que, au cours de la dernière décennie, une combinaison de diverses forces a entraîné une augmentation considérable de la disponibilité d’épargne mondiale, un excès d’épargne mondiale; ce qui permet en partie d’expliquer l’augmentation du déficit des États-Unis et le niveau relativement bas des taux d’intérêt à long terme dans le monde aujourd’hui» Il fit remarquer que, bien que cet excès fournissait l’afflux de fonds aux États-Unis pour couvrir leur déficit de balance de paiement tout en gardant les taux d’intérêt bas, ces fonds n’étaient pas utilisés pour financer l’investissement. Ils étaient plutôt utilisés pour augmenter la consommation et la construction immobilière.
Les remarques de Bernanke portent vers un autre élément considérable de la situation: les fonds qui affluent aux États-Unis ne sont pas déployés pour financer un investissement productif, un investissement qui entraînerait une augmentation de l’offre de biens sur le marché mondial et qui aiderait ainsi à diminuer le déficit commercial des États-Unis. Au lieu de cela, ils financent des formes de dépenses qui nécessiteront plus d’importations, accroissant ainsi le déficit et créant le besoin d’un afflux encore plus grand de fonds.
Le correspondant en matière d’économie du Financial Times, Martin Wolf, a publié un article le 13 juin 2005 intitulé : «Le paradoxe de l’épargne». «Des choses étranges se produisent dans l’économie mondiale: des taux d’intérêts en baisse pour des titres à long terme, des écarts qui diminuent entre les rendements des actifs à faible et à haut risque, de larges déficits fiscaux et d’énormes ‘déséquilibres’ dans les paiements mondiaux ne devraient pas, en temps normal, coïncider. Que se passe-t-il donc? La réponse, en un mot, est un excès mondial de désir d’épargnes dans un contexte de faible investissement, de faible inflation et d’économies sans cesse plus intégrées».
«Pour comprendre le présent», poursuivit-il, «nous devons retourner dans les années 30. Le ‘paradoxe de l’épargne’ était l’idée la plus contraire à l’intuition et, pour l’économiste classique, l’idée la plus répréhensible moralement, théoriquement et pratiquement de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie de John Maynard Keynes, publiée en 1936, en réaction à la Grande dépression. Il est possible, argumentait-il, pour le secteur privé de vouloir épargner plus qu’il ne souhaite investir. Ceci est le paradoxe: ce qui est bon pour des individus peut être mauvais pour une économie. Aujourd’hui, au début d’un nouveau millénaire, l’avertissement de Keynes est à nouveau pertinent» Selon Wolf, nous vivons encore une fois dans un «monde keynésien»
À première vue, ceci est une conclusion plutôt extraordinaire, venant du commentateur économique en chef de l’un des plus importants journaux financiers du monde. Mise à part toute la démagogie à propos des merveilles du marché mondial, ainsi que les prédictions de meilleure croissance économique depuis deux décennies, il tire la conclusion que l’économie mondiale affiche certains des mêmes problèmes que durant la décennie dévastatrice de 1930. Le «monde keynésien», comme il le surnomme, n’était pas seulement un monde de récession, mais de protectionnisme accru et de conflits de plus en plus profonds entre les grandes puissances capitalistes, qui ont mené finalement à la guerre.
Une autre analyse de «l’énigme du taux d’intérêt» a été mise de l’avant par le gouverneur de la Banque de réserve d’Australie, Ian Macfarlane. Selon celui-ci, «l’explication la plus prometteuse et celle qui part des pays ayant un surplus et tente de montrer pourquoi l’épargne nationale est beaucoup plus élevée que l’investissement national dans ces pays» Étant donné que les pays asiatiques ont d’importants surplus, d’autres pays doivent être déficitaires.
«Si aucun autre pays n’était prêt à avoir un déficit, alors l’économie mondiale entrerait dans une spirale descendante avec une épargne ex-ante plus grande que l’investissement ex-ante. Évidemment, les pays qui auront des déficits seront ceux où les consommateurs, les entreprises et les gouvernements seront les plus disposés à dépenser et dont les systèmes financiers seront les plus efficaces pour jouer le rôle de médiateur dans le flux d’épargne mondiale».
Selon cette analyse, les dettes et les déficits des États-Unis sont nécessaires pour maintenir une croissance économique mondiale et prévenir une «spirale descendante» vers une récession mondiale face à un manque d’opportunités d’investissement comparé au niveau d’épargne. Dans les années 30, lorsque Keynes a été confronté à cette situation, il avait préconisé une augmentation du niveau de dépense du gouvernement pour compenser les manques de la demande effective causés par le manque d’investissement. Maintenant, nous avons un genre de keynésianisme mené par le consommateur, financé par de faibles taux d’intérêt et une dette croissante.
Une crise financière mondiale
Sous cet angle, il devient évident que la source du problème n’est pas les États-Unis. La croissance du déficit des États-Unis et le développement de la dette, la bulle immobilière et toutes les autres contradictions financières croissantes de l’économie américaine sont l’expression de profonds problèmes dans le processus d’accumulation de l’économie capitaliste mondiale au complet.
Lorsque la crise asiatique a débuté en 1997-98, le Comité International avait expliqué que ce n’était pas, en réalité, une crise «asiatique», ni le manque de marchés, ni le capitalisme de copinage, ni les diverses autres explications fournies à l’époque, mais le résultat des contradictions à l’intérieur de l’économie mondiale. Ces contradictions se sont d’abord exprimées en Asie, mais ont ensuite apparu dans la situation de la dette russe et de la crise du système financier mondial, à la suite de l’effondrement du fonds spéculatif américain LTCM (Long Term Capital Management), en septembre 1998.
Jusqu’à ce que la crise se déclenche, la région de l’Asie de l’Est avait la plus forte croissance de toute l’économie mondiale; elle a été responsable d’environ 50 pour cent de la croissance mondiale durant la première moitié des années 1990. D’où les déclarations de «miracle économique» par la Banque mondiale. Au début de la crise, il y eut une sévère contraction économique. L’investissement diminua abruptement et demeura faible. Après 1997-98, l’investissement en Asie, excluant le Japon et la Chine, diminua entre 7 et 8 pour cent du PIB. Soit, d’un niveau de près de 35 pour cent du PIB à environ 25 pour cent.
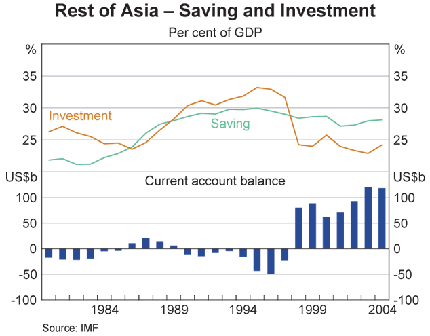
Bien sûr, comme toutes les explications keynésiennes, Macfarlane s’arrête au point où il devrait véritablement commencer. La question importante est celle-ci: quelle est la cause du manque d’investissement qui a conduit à cet «excès d’épargne mondiale»? Ce phénomène est l’expression, tout comme il l’était dans les années 30, de la tendance à la baisse des taux de profit. Cette tendance ne signifie pas qu’une crise se développe lorsque les profits tombent à zéro, un fait oublié par ceux qui insistent que l’analyse de Marx ne fournit pas d’explication, car un taux de profit en déclin signifie quand même qu’il existe des opportunités d’investissement, mêmes si elles procurent un taux de rendement plus bas.
Bien avant que le taux de profit global atteigne zéro, une crise peut survenir lorsque les profits d’investissements additionnels deviennent négligeables. Ainsi, le taux de profit moyen peut demeurer relativement élevé mais si le taux de profit d’investissements additionnels est très bas -- la façon par laquelle la tendance à la baisse du taux de profit se manifeste -- une crise se développera. Dans une telle situation, l’investissement sera diminué et les investisseurs n’entreprendront pas de nouveaux projets. Au lieu de cela, ils garderont leur argent en attendant de meilleurs jours, en cherchant d’autres opportunités dans les marchés financiers ou dans la spéculation.
De telles décisions sont lourdes de conséquences car l’investissement joue le rôle central dans la dynamique de l’économie capitaliste. Comme les premières critiques du système capitaliste firent remarquer -- et leur analyse a été répétée sans cesse par les partisans de la théorie de la sous-consommation -- l’existence même du profit capitaliste signifie que les salaires des travailleurs ne suffisent pas à reconvertir les marchandises qui émergent de la production capitaliste en argent.
Mais si c’est le cas, comment fonctionne l’économie capitaliste? La consommation par les travailleurs n’est pas la seule source de demande effective. La demande pour les biens de production et, dans celle-ci, la demande pour les biens de production qui répondront à une demande future, c’est-à-dire l’investissement, joue le rôle clé, et pas seulement en maintenant la production au même niveau mais en l’augmentant. L’investissement va plus loin que le niveau actuel de développement économique et il crée les marchés du futur. Si ce processus est stoppé, alors l’économie capitaliste subit une «spirale descendante».
Le déclenchement d’une telle crise peut être empêché si une autre source de demande effective peut être trouvée pour remplacer l’investissement manquant. Toutefois, de telles mesures en elles-mêmes ne résoudront pas la crise, qui a ses origines, non pas dans le manque de demande effective comme telle, mais dans l’insuffisance de la plus-value par rapport à la masse du capital: une insuffisance qui se manifeste par une «spirale descendante» du taux de profit. Parce qu’elles ne peuvent résoudre le problème fondamental, les mesures stimulatrices mèneront inévitablement au développement de nouvelles contradictions et de nouveaux problèmes.
Dans la situation actuelle, même si les mesures financières entreprises par les autorités américaines, maintien de liquidité et régime de faible taux d’intérêt, ont empêché les États-Unis et l’économie mondiale au complet d’entrer en récession, elles ont aussi créé d’importantes sources d’instabilité. L’énorme augmentation de liquidité et l’apparition d’un système financier mondial, qui sont au-delà de tout contrôle de n’importe quelle autorité, combinés à une recherche de plus en plus désespérée pour un retour sur l’investissement -- autrement dit, le profit -- ont créé les conditions pour une crise financière. À ce sujet, divers banquiers centraux et autorités financières ont récemment abordé le problème.
Lors d’un discours en septembre dernier, le directeur général de la Banque des règlements internationaux, Malcolm Knight, a parlé du «rythme sans précédent» avec lequel s’était développé le système financier mondial durant les trente dernières années. Avec la fin des taux de change fixes en 1973, des marchés de change au comptant et à terme se sont développés, suivis d’un développement des marchés de titres gouvernementaux et ensuite de nouveaux marchés dans lesquels les investisseurs pouvaient s’assurer contre les risques ou effectuer une réassurance. Cela résultat en un «système financier mondial qui semble être devenu plus résistant aux chocs financiers émanant de pays individuels»
«Le système financier mondial d’aujourd’hui», conclu-t-il, «est largement plus efficace et résistant aux petits ou moyens chocs qu’il ne l’était 20 ans plus tôt, ou même une décennie plus tôt. Et garder le système financier en équilibre ne requiert plus les interventions directes, qui ne proviennent pas du marché, des banques centrales et des régulateurs qui semblaient nécessaires en ces temps anciens. Mais le système financier complexe d’aujourd’hui, dominé par le marché, crée aussi plus d’incitatifs que par le passé pour ‘chercher un plus grand retour sur l’investissement’, une capacité supplémentaire à augmenter le niveau d’endettement, une plus grande portée pour agir sur les sentiments historiques déstabilisateurs de l’euphorie et de la morosité. En bref, notre système financier peut être enclin à de nouvelles combinaisons de risques négatifs qui pourraient se répercuter dans l’économie réelle.»
L’économiste en chef du FMI, Raghuram Rajan, a fait une évaluation semblable dans un document publié en août dernier.
«Bien que le système actuel exploite de meilleure façon la capacité de risque de l’économie en répartissant mieux les risques, il prend en charge plus de risques qu’avant. De plus, les liens entre les marchés, et entre les marchés et les institutions, sont maintenant plus prononcés. Bien que cela aide le système à gérer les petits chocs, cela le rend plus vulnérable à d’importants chocs structurels: de profondes modifications des prix des actifs ou des changements dans le montant total de liquidités... En bref, même si je crois que l’on pourrait dire sans trop se tromper que le système financier est plus stable la plupart du temps, il y a aussi la possibilité d’une instabilité excessive lors de périodes très difficiles…. Malheureusement, nous ne saurons pas si l’on doit prendre ces préoccupations au sérieux tant que le système n’aura pas été testé. Le mieux qui peut survenir est que le système affronte des chocs de plus en plus importants, détermine ce qui manque à chaque fois, et devienne ainsi plus résistant... Le danger est que, avant que l’économie ne soit testée, elle soit frappée par la pire des crises».
Et quelles pourraient être les conditions pour un tel événement?
«Un scénario probable serait celui où l’économie connaîtrait une période d’aversion pour le très faible risque (par exemple, une période soutenue de faibles taux d’intérêt) et où les prix des actifs seraient décalés, créant la possibilité d’un réalignement comportant des conséquences négatives qui se répercuteraient à travers l’économie.»
En bref, une période semblable à la nôtre.
À suivre
|
Copyright
1998 - 2012 |
|
